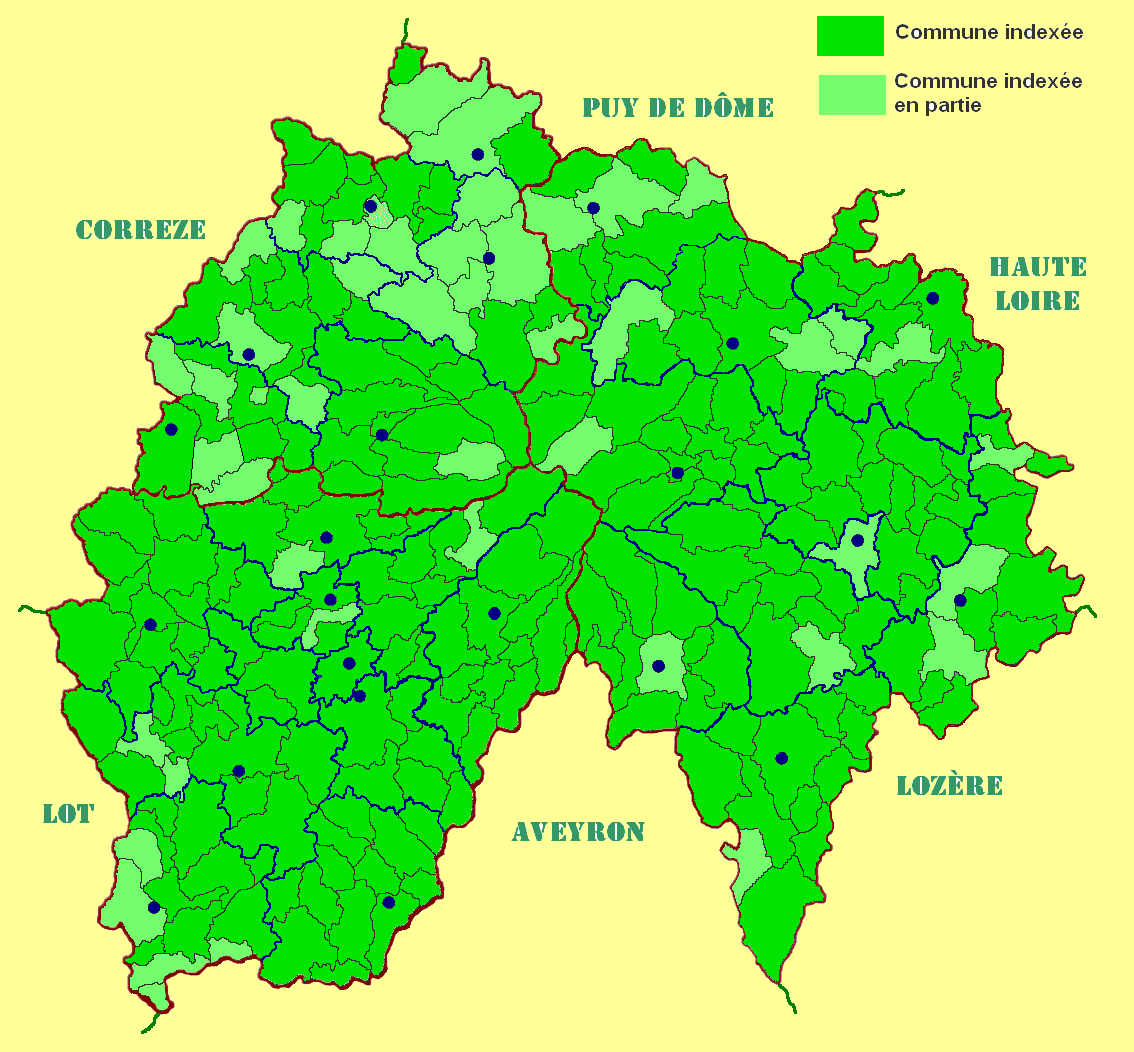Votre généalogie dans le cantal
Bienvenue sur notre site
 Vous êtes sans doute venu sur le site Aprogemere à la recherche de quelques ancêtres « cantalous » dans le pays vert et nous mettons tout en œuvre pour vous y aider.
Vous êtes sans doute venu sur le site Aprogemere à la recherche de quelques ancêtres « cantalous » dans le pays vert et nous mettons tout en œuvre pour vous y aider.
Nos adhérents indexent les registres d’état civil depuis maintenant près de vingt ans et les actes notariaux depuis plus de dix ans, ce qui nous permet d’avoir sur le site la presque totalité des communes indexées (3 593 082 actes) et 743 425 actes notariés. Nous n’avons pas oublié nos Migrants (nés dans le cantal et morts ailleurs) avec 126 314 références.
Notre forum vous permettra de poser toutes sortes de questions et de rechercher un « cousinage » qui fera progresser vos recherches. Sur bon nombre de villages ou pays, vous trouverez des adhérents « spécialistes » grâce à leurs recherches antérieures et actuelles.
Dans l’Espace réservé aux adhérents, vous pourrez, si vous le souhaitez, créer une page personnelle vous présentant succinctement et permettant éventuellement d'accéder à la généalogie que vous nous confierez, sous forme d'un simple fichier gedcom. Une base Cousinage avec un outil de recherche avancée vous permettra de retrouver tous les ancêtres communs avec d’autres adhérents, « vos cousins ». Des répertoires d’actes de notaires vous seront également accessibles. Peu à peu, grâce à la participation des adhérents, des outils ou des sources d'informations s'ajoutent sur notre site pour faciliter vos recherches ou satisfaire votre curiosité pour l'histoire locale.
De nombreux adhérents résidant à proximité d’Aurillac, nous sommes en mesure de numériser les documents nécessaires à vos recherches et qui ne sont pas encore présentés sur le site des Archives départementales avec qui nous développons un partenariat fructueux.
Très active, l’association participe et organise plusieurs manifestations annuelles dans le Cantal. Une permanence se tient mensuellement au siège de l’association et l’antenne Ile de France propose tous les trimestres une rencontre à Paris. Ce sont des lieux d’échange et d’entraide dans un esprit désintéressé et convivial.
Espérant vous compter parmi les nôtres
Le Conseil d’administration
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com